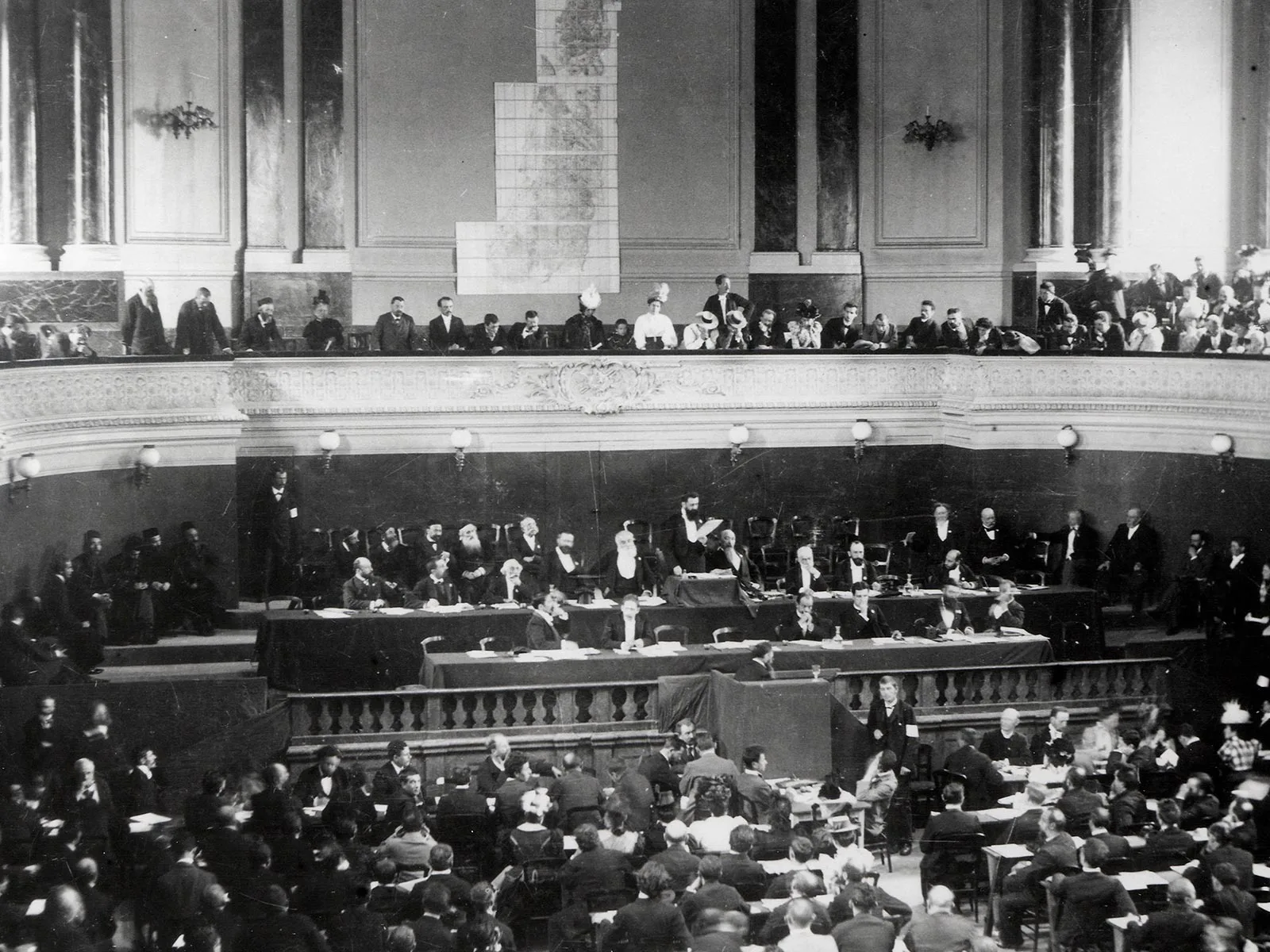La résistance des Nidwaldiens
À la fin du XVIIIe siècle, les soldats français renversèrent la Suisse. Dans l’ensemble, la Confédération n’opposa qu’une faible résistance face aux Français. Après les Bernois en mars et les Schwyzois en mai, les Nidwaldiens opposèrent une résistance farouche au nouveau régime.
Neuf années s’étaient écoulées depuis la prise de la Bastille et six depuis le renversement de la monarchie à Paris. Neuf années durant lesquelles l’Europe tout entière avait eu les yeux rivés sur la France. C’est avec incrédulité et consternation que les Suisses avaient lu les rapports de l’exécution de Louis XVI, suivi le déroulement du règne de la Terreur des Jacobins et assisté à l’ascension de Napoléon jusqu’à ce qu’il devienne Premier consul de la République. En Suisse, certains rêvaient aussi d’une révolution et d’autres restaient fidèles au régime en place.
En hiver 1798, le général français Balthasar von Schauenburg avança depuis le nord en direction de Berne, tandis que d'autres troupes sous le commandement du général Brune approchaient depuis l'ouest. Les forces françaises étaient techniquement supérieures aux milices autochtones. Le gouvernement bernois abdiqua début mars, les troupes du général Schauenburg s'emparèrent le trésor public et emmenèrent les ours de Berne à Paris en guise de butin. L’invasion française se déroula ainsi presque partout en Suisse. Les Français conquirent occupèrent le Moyen-Pays sans rencontrer de grande résistance, la République helvétique fut proclamée et dotée d’un gouvernement central. Celui-ci siégeait dans la première capitale: Aarau. En Argovie, jusqu’alors pays sujet de Berne, mais aussi dans le Pays de Vaud, le renversement fut unanimement salué. Mais ce ne fut pas le cas partout. Uri et Schwytz rejetèrent la Constitution dictée par la France, avant d’être contraints de l’adopter à l’issue d’autres combats. Seul Nidwald continua de résister.

Les Nidwaldiens se formalisaient de l’absence de Dieu dans la Constitution et de la liberté d’établissement et de culte. Les prêtres locaux intensifièrent la colère générale. Finalement, le gouvernement helvétique posa un ultimatum que les Nidwaldiens rejetèrent sans le lire et ordonna à Schauenburg d'intervenir. Le 9 septembre, un combat éclata. Une bataille héroïque ou, pour le formuler autrement, entièrement dénuée de sens, car les Nidwaldiens ne faisaient pas le poids. Les deux camps perdirent une centaine d’hommes. Stans et de nombreux villages tels que Buochs et Stansstad furent dévastés, ce qui fit près de 300 victimes supplémentaires.
Jusqu’à la fin, les Nidwaldiens avaient espéré une intervention de l’armée autrichienne, mais celle-ci ne marcha qu’en octobre sur les Grisons. Un an plus tard, les troupes du général Souvorov attaquèrent à leur tour les Français. S’ensuivirent de pénibles allées et venues d’armées, dont pâtit la société civile suisse. Et le gouvernement ne réussit pas à atténuer la détresse des gens.